➡️ Découvrir le projet Runcorner : la marketplace de seconde main 100% running
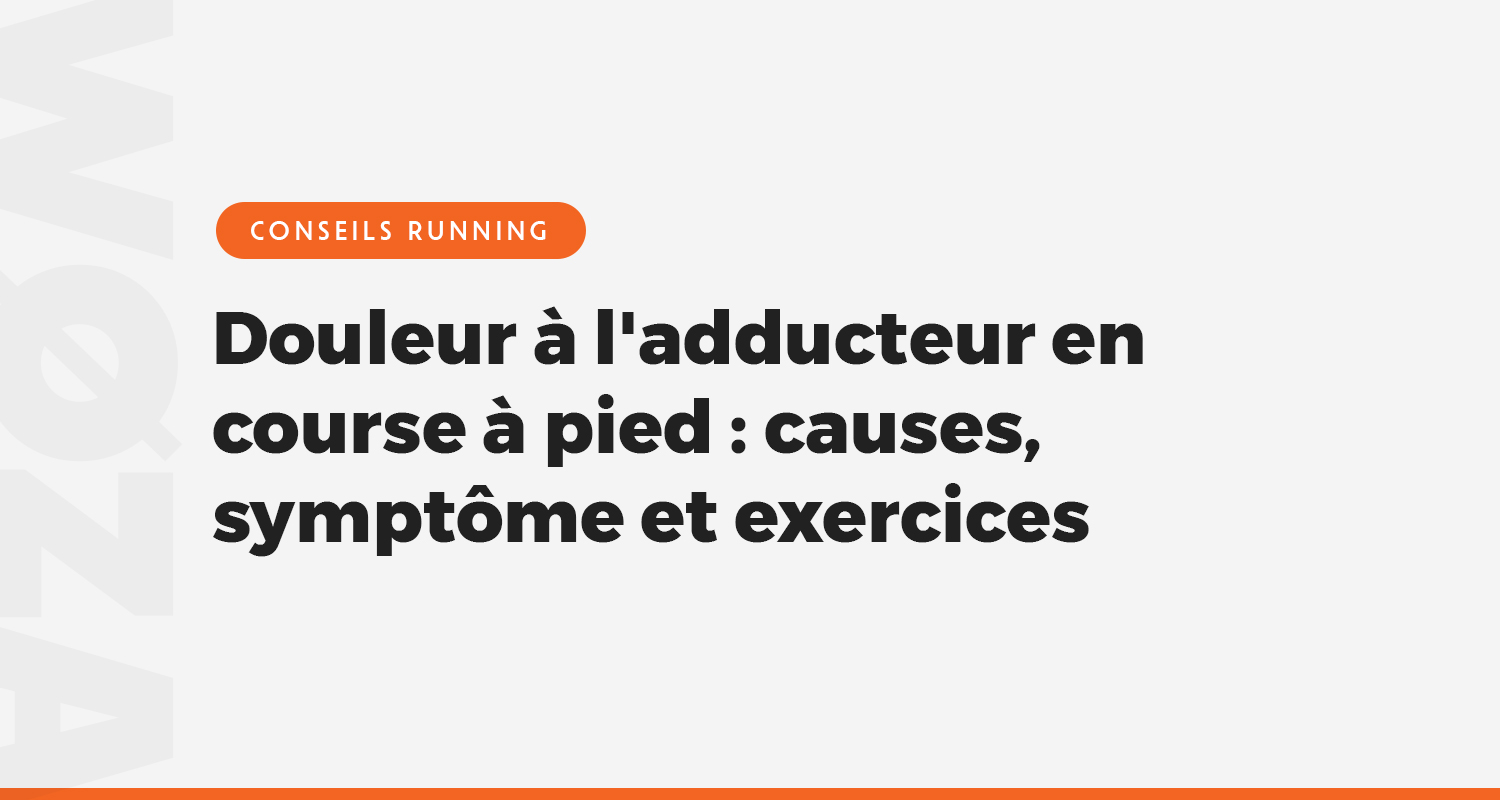
Lorsque je discute avec des coureurs, débutants comme confirmés, il y a toujours un sujet qui revient : la douleur à l’adducteur. C’est l’une de ces gênes sournoises qui commence par une petite tension à l’intérieur de la cuisse puis qui finit par gâcher les sorties, ralentir la progression et, parfois, obliger à s’arrêter complètement. Si vous êtes ici, c’est peut-être que vous avez déjà ressenti cette pointe désagréable, ou que vous cherchez à comprendre comment l’éviter.
En course à pied, les adducteurs jouent pourtant un rôle essentiel : ils stabilisent le bassin, contrôlent les mouvements latéraux et contribuent à une foulée fluide. Et comme beaucoup de muscles en soutien, on ne les remarque vraiment que lorsqu’ils se mettent à protester.
Douleur à l’adducteur en running : ce qu’il faut retenir
La douleur à l’adducteur en course à pied n’est pas une fatalité, mais un signal précieux que votre corps vous envoie. Elle peut survenir à cause :
- de surcharges d’entraînement
- de déséquilibres musculaires
- d’une mauvaise posture
- d’un manque d’échauffement.
Selon son intensité, elle peut aller de la simple fatigue musculaire aux élongations, claquages, tendinopathies ou même à la pubalgie.
Pour la gérer efficacement, il est essentiel de reconnaître les symptômes, de réduire ou arrêter la course, et de consulter un professionnel si nécessaire. La rééducation passe par une approche progressive : activation isométrique, renforcement ciblé des adducteurs, du tronc et des fessiers, et travail de mobilité et d’assouplissement.
Enfin, intégrer régulièrement des étirements adaptés comme le papillon assis, la fente latérale ou l’écart latéral assis permet de prévenir les récidives et de maintenir vos adducteurs souples et résistants.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Anatomie des adducteurs : comprendre ce qui se passe
Pour comprendre pourquoi vos adducteurs se manifestent parfois un peu trop vivement, il faut d’abord savoir comment ils fonctionnent. Ces muscles, souvent méconnus, jouent pourtant un rôle déterminant dans chaque foulée.
Les cinq muscles qui composent les adducteurs
Le groupe des adducteurs regroupe cinq muscles situés à l’intérieur de la cuisse :
- le long adducteur
- le court adducteur
- le grand adducteur
- le pectiné
- le gracile.
Chacun a sa particularité, mais tous travaillent ensemble pour rapprocher les jambes, stabiliser le bassin et accompagner les mouvements complexes de la course. Leur position centrale en fait des muscles sollicités en permanence, même lorsque vous avez l’impression de ne pas les utiliser.
Le rôle des adducteurs en course à pied
Stabilisation du bassin
Ces muscles jouent un rôle clé dans le maintien de l’alignement du bassin. Ils évitent que celui-ci s’affaisse à chaque appui. En clair, plus vos adducteurs sont forts, moins vous balancez latéralement. Cela améliore directement votre confort et réduit le risque de compensation ailleurs, comme au niveau du dos ou des hanches.
Contrôle des mouvements latéraux
Même si la course est un sport principalement linéaire, votre corps effectue de nombreux micro-ajustements latéraux. Les adducteurs contrôlent ces mouvements parasites et garantissent une foulée plus stable.
Lors d’un trail technique, j’ai pris conscience de leur importance : à chaque pierre glissante ou appui irrégulier, ce sont eux qui empêchaient mes jambes de partir dans tous les sens. Sans ce contrôle, les blessures arrivent vite.
Participation à l’efficacité de la foulée
Les adducteurs interviennent aussi pour ramener la jambe vers l’axe du corps. Ils contribuent ainsi à une foulée fluide, symétrique et économe en énergie. Quand ils sont en forme, vous courez plus naturellement, avec une meilleure sensation de glisser sur la route ou les sentiers.
Pourquoi les adducteurs sont sensibles à la surcharge en course
Ces muscles travaillent à chaque pas, souvent en sous-main, sans jamais bénéficier d’un repos total. Ils compensent dès qu’un autre groupe musculaire faiblit, notamment si les fessiers ou le tronc manquent de stabilité. La surcharge arrive alors rapidement, surtout si vous augmentez le volume d’entraînement ou les intensités sans progression maîtrisée.
Pourquoi a-t-on mal aux adducteurs en course à pied ?
Les douleurs aux adducteurs ne surviennent jamais par hasard. Elles apparaissent souvent lorsqu’un élément de votre routine d’entraînement se dérègle, ou lorsque la charge dépasse ce que votre corps peut encaisser à ce moment-là. Pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d’examiner les causes les plus fréquentes. Vous verrez qu’elles sont souvent plus simples qu’on ne le pense.
Surcharges d’entraînement et fatigue musculaire
L’une des causes les plus courantes reste une augmentation trop rapide du volume ou de l’intensité. Passer de deux à quatre séances par semaine, ajouter du fractionné brutalement ou multiplier les sorties longues met une pression énorme sur les adducteurs. Comme ils interviennent dans la stabilité, ils doivent s’adapter à chaque nouvelle contrainte et parfois ils n’y parviennent pas.
Les adducteurs n’aiment pas non plus l’enchaînement de séances intenses, comme des répétitions de côtes ou des séries rapides. Ces séances sollicitent fortement les muscles stabilisateurs, qui n’ont pas toujours le temps de récupérer. J’ai déjà vu des coureurs motivés accumuler les entraînements costauds pendant quinze jours, puis se retrouver bloqués par une douleur interne à la cuisse. À vouloir aller trop vite, on finit souvent par être contraint de ralentir.
Déséquilibres musculaires
Les douleurs aux adducteurs apparaissent aussi lorsque certains muscles travaillent plus que d’autres. Si vos adducteurs sont trop faibles par rapport aux fessiers, quadriceps ou ischio-jambiers, ils compensent en permanence. Ils se fatiguent alors plus vite et deviennent vulnérables.
Ce manque d’équilibre crée un déficit de stabilité du bassin, ce qui augmente les mouvements parasites à chaque pas. Et plus votre bassin bouge, plus vos adducteurs doivent rattraper la trajectoire.
Personnellement, c’est un déséquilibre entre mes fessiers et mes adducteurs qui m’a causé mes premiers soucis : dès que j’ai renforcé le bas du corps de manière homogène, tout est rentré dans l’ordre. C’est une piste que je recommande vraiment d’explorer.
Mauvaise biomécanique ou posture
La manière dont vous courez influence directement la sollicitation des adducteurs. Une foulée instable, un bassin mal aligné ou des genoux qui rentrent vers l’intérieur (valgus) augmentent la pression sur cette zone. Les muscles doivent alors corriger votre posture à chaque appui, parfois pendant des milliers de pas.
Le terrain joue également un rôle : courir en sous-bois, sur des chemins techniques ou enneigés demande un effort constant de stabilisation. Si vous ajoutez à cela des chaussures usées, qui n’assurent plus leur rôle d’amortissement, vous obtenez une recette parfaite pour sursolliciter les adducteurs.
Manque d’échauffement
Un échauffement bâclé ou absent crée des tensions inutiles. Les muscles, encore froids, ne sont pas prêts à absorber les impacts. Même si vous avez hâte de vous lancer, prenez toujours le temps de préparer votre corps : vos adducteurs vous remercieront. Quelques minutes de mobilisation et d’activation suffisent souvent à éviter la gêne que l’on ressent parfois dès les premières foulées.
Traumatismes et mouvements brusques
Enfin, une douleur peut survenir après un mouvement imprévu ou trop violent. C’est fréquent en trail, quand le pied part sur le côté, ou lors d’un sprint où l’on force sans être parfaitement aligné. Les sports collectifs, qui impliquent beaucoup de changements de direction, sont également connus pour provoquer des tensions au niveau des adducteurs.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Les pathologies possibles : identifier la nature de la douleur
Quand une douleur apparaît à l’intérieur de la cuisse, il n’est pas toujours évident d’en déterminer l’origine. Pourtant, savoir reconnaître le type de blessure permet de réagir rapidement et d’éviter qu’elle ne s’aggrave.
Fatigue et microdéchirures
La forme la plus courante reste la simple fatigue musculaire, parfois accompagnée de microdéchirures au niveau des fibres. La douleur apparaît progressivement, souvent après plusieurs sorties exigeantes. Elle se manifeste par une gêne diffuse, une sensation de tiraillement et une raideur au réveil. Dans ce cas, le muscle proteste, mais il n’est pas gravement atteint. Avec un peu de repos et un retour au calme réfléchi, tout rentre généralement dans l’ordre.
Ce type de douleur est typique lorsque l’on augmente un peu trop vite la charge. Il m’est arrivé de ressentir cette gêne après un cycle de fractionné où j’avais négligé les jours de récupération. Heureusement, en levant le pied quelques jours, la situation s’est rapidement calmée.
Élongation, claquage ou déchirure
Lorsque la douleur est plus vive, brutale, et que vous pouvez pointer exactement l’endroit où elle se situe, on se rapproche d’une élongation, d’un claquage ou d’une déchirure. Ces blessures surviennent après un mouvement forcé, un départ trop rapide ou une foulée latérale incontrôlée.
Les symptômes typiques sont faciles à repérer :
- douleur aiguë immédiate,
- parfois un hématome,
- impossibilité de reprendre la course sans douleur intense,
- difficulté à adducter la jambe ou à marcher normalement.
Dans ces cas-là, mieux vaut arrêter immédiatement l’effort et consulter. Ce n’est pas le type de blessure que l’on gère en continuant l’entraînement.
Tendinopathie des adducteurs
La tendinopathie est une autre pathologie fréquente, surtout chez les coureurs assidus. Ici, ce n’est pas le muscle lui-même qui pose problème, mais le tendon, sursollicité au fil du temps. La douleur est progressive, souvent plus marquée en début d’effort, puis elle se calme légèrement avant de revenir ensuite.
Vous pouvez aussi ressentir une gêne lors de certains mouvements spécifiques : croiser les jambes, lever le genou, ou ramener la jambe vers le centre. Ce type de blessure met plus de temps à se résoudre, car le tendon aime la régularité et déteste les variations brusques de charge.
Pubalgie : quand la douleur devient chronique
La pubalgie, souvent redoutée des sportifs, représente une forme plus complexe et plus chronique de douleur. Elle touche la zone du pubis et peut irradier vers les adducteurs ou les abdominaux. Les adducteurs y jouent un rôle central, car leur insertion se situe très près de la symphyse pubienne. Lorsque ces muscles tirent trop fort, ou de manière répétée, ils finissent par irriter cette zone sensible.
La pubalgie apparaît souvent après une longue période de déséquilibre musculaire ou de surcharge. La douleur devient chronique, parfois sourde mais persistante, et elle s’accentue lorsque vous accélérez ou changez de direction. C’est une blessure qui demande de la patience, un travail de rééquilibrage et un accompagnement professionnel.
Symptômes : comment reconnaître une douleur à l’adducteur ?
Identifier une douleur à l’adducteur n’est pas toujours simple, surtout si vous n’avez jamais été confronté à ce type de gêne auparavant. Pourtant, certains signes reviennent très souvent. En apprenant à les reconnaître, vous pourrez réagir plus tôt et éviter que la situation ne dégénère. Voyons ensemble les symptômes les plus caractéristiques.
Douleur à l’intérieur de la cuisse
Le signe le plus évident reste une douleur localisée à l’intérieur de la cuisse, parfois près du pubis. Elle peut être diffuse ou très précise selon la gravité de la blessure. Cette sensation peut apparaître à froid, dès les premières foulées, ou au contraire après quelques minutes, quand le muscle commence à se solliciter davantage.
Gêne dans certains mouvements
Une douleur aux adducteurs provoque souvent une gêne dans les mouvements d’adduction, c’est-à-dire lorsque vous ramenez la jambe vers l’intérieur. Les changements de direction, même légers, deviennent désagréables. Monter dans une voiture, croiser les jambes ou simplement se retourner rapidement peut réveiller cette tension. C’est un signe clair que le muscle n’est pas prêt à absorber les contraintes habituelles.
Raideur et manque d’amplitude
Beaucoup de coureurs décrivent une raideur persistante : la jambe semble moins mobile, moins souple, comme si quelque chose tirait à l’intérieur de la cuisse. Le manque d’amplitude se fait surtout sentir au réveil ou après une longue position assise. Si vous avez l’impression que votre jambe se déplace moins librement, c’est souvent un indicateur d’irritation musculaire.
Sensation de brûlure ou d’inflammation
Une sensation de brûlure, de chaleur ou d’inflammation est fréquente, en particulier dans les tendinopathies. Le muscle ou le tendon réagit à la surcharge et devient plus sensible au toucher. Ce type de symptôme montre que le tissu est irrité et qu’il faut revoir la charge d’entraînement.
En cas de déchirure : symptômes immédiats
Lors d’une élongation, d’un claquage ou d’une déchirure, les symptômes sont beaucoup plus marqués :
- douleur vive et soudaine, comme un coup de poignard,
- apparition possible d’un gonflement ou d’un hématome,
- impossibilité immédiate de continuer à courir,
- difficultés à marcher normalement.
Dans ce cas, il faut arrêter immédiatement et éviter toute mise en tension du muscle. Ce sont des situations qui nécessitent une prise en charge rapide.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Que faire lorsque la douleur apparaît ?
Quand la douleur se manifeste, la priorité est de réagir intelligemment. Beaucoup de coureurs continuent malgré l’inconfort, en espérant que « ça passe ». Malheureusement, c’est souvent ce qui transforme une simple irritation en blessure plus sérieuse. En adoptant les bons réflexes dès les premiers signaux, vous augmentez considérablement vos chances de récupérer vite et bien.
Arrêter ou réduire la course
Le premier geste, même si ce n’est pas toujours celui que l’on préfère, consiste à ralentir. Parfois, arrêter la course quelques jours suffit pour laisser le muscle se calmer. Dans les cas plus légers, vous pouvez simplement réduire la durée, la fréquence ou l’intensité de vos sorties.
L’idée n’est pas de tout couper d’un coup, mais d’éviter de solliciter un muscle déjà irrité. En pratique, si la douleur persiste pendant la foulée ou s’intensifie après la séance, mieux vaut lever le pied. Ce petit ajustement précoce peut vous éviter plusieurs semaines d’arrêt forcé.
Consulter un professionnel
Si la douleur est aiguë, persistante ou si vous avez un doute sur la nature de la blessure, consulter un médecin du sport ou un kinésithérapeute est la meilleure décision. Ces professionnels peuvent identifier précisément le problème grâce à :
- la palpation pour localiser l’origine exacte de la douleur,
- des tests spécifiques pour déterminer si le muscle, le tendon ou l’insertion est touché,
- une échographie, souvent utile pour évaluer une élongation ou une déchirure,
- ou une IRM pour les cas plus complexes (pubalgie, suspicion de lésion profonde).
Cette étape permet d’éviter le piège du « je crois que c’est juste une contracture » alors qu’il s’agit parfois d’une tendinopathie installée.
Les traitements initiaux
Dans les premiers jours, l’objectif est de calmer l’inflammation et de permettre au tissu musculaire de récupérer sans stress.
- Glace : appliquer du froid 10 à 15 minutes, deux à trois fois par jour, aide à réduire la douleur et l’inflammation.
- Réduction de charge : limiter les mouvements qui tirent sur les adducteurs (sprints, changements de direction, séances intenses).
- Anti-inflammatoires : uniquement si un médecin les prescrit. Ils peuvent être utiles dans les phases aiguës, mais pas systématiques.
- Massages et thérapies manuelles : un kiné peut travailler sur les tensions adjacentes, améliorer la circulation et faciliter la récupération. Ce type de prise en charge fait souvent une vraie différence, surtout si la zone est contractée.
En respectant ces étapes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour éviter que la douleur ne devienne chronique.
Rééducation : renforcer pour guérir durablement
La rééducation des adducteurs ne se limite pas à attendre que la douleur disparaisse. Pour éviter qu’elle ne revienne, il faut reconstruire progressivement la force, la stabilité et la mobilité du bassin. Cette phase demande un peu de patience, mais elle paye vraiment sur le long terme.
Phase isométrique (douce)
Dans les premiers jours de rééducation, l’objectif est de réactiver les adducteurs sans les faire bouger. L’isométrie permet de travailler en douceur, sans étirer le muscle ni provoquer de tension excessive.
Un exercice très efficace consiste à placer un ballon ou un coussin entre les genoux, puis à le presser pendant 10 à 20 secondes. L’effort est faible au début, puis augmente progressivement. Cet exercice réveille les fibres musculaires tout en respectant la sensibilité de la zone.
Renforcement progressif
Une fois que la douleur a diminué, on peut passer à un renforcement plus dynamique. Le but est de redonner aux muscles leur capacité à stabiliser le bassin et à absorber les contraintes de la course.
Renforcement des adducteurs
- Élévations de jambe sur le côté en position allongée
- Montées de genoux avec bande élastique
- Adduction en position debout, pied dans une sangle
L’idée est de monter l’intensité petit à petit, tout en veillant à maintenir un mouvement contrôlé.
Renforcement du tronc (abdos, transverse)
Les adducteurs travaillent en étroite collaboration avec le tronc. Un manque de stabilité se répercute toujours sur eux.
- Gainage ventral
- Gainage latéral
- Exercices de respiration profonde pour activer le transverse
Ces exercices renforcent la base de votre posture en course.
Renforcement des fessiers et stabilisateurs du bassin
Les fessiers, en particulier le moyen fessier, jouent un rôle essentiel pour limiter les mouvements parasites.
- Montée de bassin (pont fessier)
- Abduction de hanche élastique
- Marche latérale avec bande
Plus vos fessiers sont solides, moins vos adducteurs compensent à chaque pas.
Travail de mobilité et assouplissement
Après avoir retrouvé un niveau de force confortable, il est temps d’améliorer la souplesse et la mobilité de l’ensemble bassin–cuisse. C’est une étape clé pour éviter les raideurs qui favorisent les blessures.
Étirements contrôlés
Les étirements doivent être doux, progressifs, sans jamais chercher l’amplitude maximale. Vous pouvez par exemple :
- vous asseoir pieds contre pieds (papillon),
- réaliser une fente latérale,
- étendre les jambes contre un mur.
Tenir chaque position 20 à 30 secondes suffit largement.
Importance de la méthode active antagoniste
Cette méthode consiste à contracter le muscle opposé avant de relâcher l’adducteur. Par exemple, contracter les fessiers ou les quadriceps pendant deux ou trois secondes, puis étirer doucement l’adducteur. Ce contraste aide le corps à se relâcher plus efficacement et améliore la qualité de l’étirement.
Exercices recommandés
Parmi les exercices efficaces, je vous recommande :
- fente latérale contrôlée,
- écart latéral assis,
- genoux qui tombent doucement vers le sol,
- posture du papillon avec pression légère,
- jambes en l’air le long d’un mur pour détendre les adducteurs en fin de séance.
Ces mouvements sont simples à réaliser, ne demandent aucun matériel particulier et s’intègrent facilement dans une routine post-entraînement.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Les meilleurs étirements pour soulager et prévenir les douleurs
Pour réduire durablement les tensions aux adducteurs et prévenir les récidives, les étirements jouent un rôle essentiel. Ils complètent le renforcement musculaire en redonnant de la mobilité au bassin et en diminuant la raideur interne de la cuisse.
En général, je vous conseille de tenir chaque étirement 20 à 30 secondes, de le répéter 2 à 3 fois, et de pratiquer ces exercices 3 à 4 fois par semaine, idéalement après une séance légère ou en fin de journée.
Papillon assis
Asseyez-vous, collez vos plantes de pieds l’une contre l’autre et laissez vos genoux tomber doucement vers le sol.
Vous pouvez poser les mains sur vos chevilles et pencher légèrement le buste vers l’avant sans forcer.
Cet étirement ouvre les hanches et relâche en douceur les adducteurs.
Conseil : imaginez que vos genoux deviennent lourds ; ne les poussez jamais avec les mains.
Genoux qui tombent au sol
Allongez-vous sur le dos, genoux pliés et pieds au sol, puis laissez les genoux s’écarter naturellement de chaque côté.
C’est un étirement passif très relaxant, idéal en fin de journée ou juste après un footing léger.
Conseil : plus vos pieds sont proches de vos fesses, plus l’étirement est intense. Ajustez selon votre confort.
Fente latérale debout
Debout, placez vos pieds écartés puis pliez l’une des jambes sur le côté, comme une fente latérale.
La jambe opposée reste tendue, ce qui étire fortement l’adducteur.
Conseil : gardez le dos droit et évitez de descendre trop bas pour ne pas mettre de tension excessive sur le genou.
Jambes en l’air contre un mur
Allongez-vous sur le dos et placez vos jambes verticalement contre un mur.
Laissez-les s’ouvrir doucement sur les côtés sous l’effet de la gravité.
C’est un étirement très doux mais redoutablement efficace pour relâcher la chaîne interne de la cuisse.
Conseil : restez dans la position 1 à 2 minutes si c’est confortable, sans chercher un écart maximal.
Écart latéral assis
Assis au sol, les jambes écartées, penchez-vous doucement vers l’avant puis à droite et à gauche.
Cet étirement sollicite toute la longueur des adducteurs.
Conseil : ne cherchez jamais à forcer l’ouverture. L’amélioration vient avec le temps et la régularité.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.

