➡️ Découvrir le projet Runcorner : la marketplace de seconde main 100% running
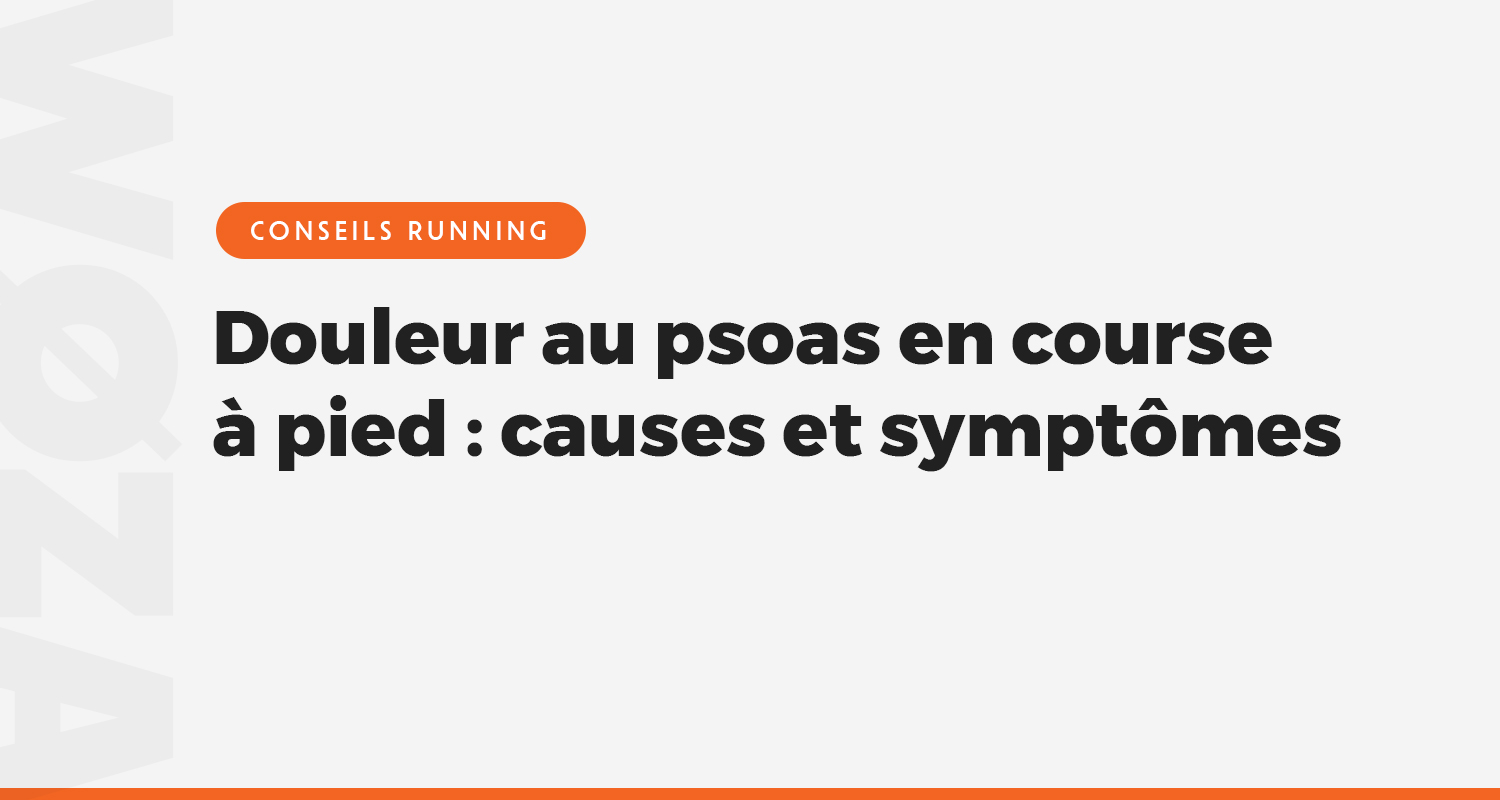
Si vous courez régulièrement, il y a de fortes chances que vous ayez déjà ressenti cette gêne profonde à l’avant de la hanche ou dans le bas-ventre. Elle s’installe souvent sans prévenir, d’abord discrète, puis de plus en plus persistante à chaque sortie. Cette douleur, c’est celle du psoas, un muscle aussi discret qu’indispensable à la course à pied.
J’ai moi-même connu cette fameuse douleur lors de ma préparation pour un semi-marathon. Au début, je pensais à une simple raideur musculaire. En réalité, mon psoas criait au secours après plusieurs semaines d’entraînement intensif sans vrai travail de mobilité. Cette expérience m’a appris que négliger ce muscle, c’est comme courir avec un maillon faible dans la chaîne : tôt ou tard, ça casse l’équilibre.
Le psoas travaille à chaque foulée. Il soulève la cuisse, stabilise le bassin et soutient la posture. Quand il se fatigue ou se raccourcit, il perturbe toute la mécanique de course. Comprendre son rôle, reconnaître les signaux d’alerte et adopter les bons réflexes devient donc essentiel pour continuer à courir sans douleur et progresser en toute sérénité.
Douleur au psoas et running : ce qu’il faut retenir
Le psoas est un muscle clé qui relie le tronc aux jambes, permettant la flexion de la hanche et la stabilité du bassin. Une douleur à ce niveau se manifeste souvent par une gêne à l’aine, une raideur, ou même un claquement lors de la foulée. Elle résulte généralement d’une surutilisation, de déséquilibres musculaires, de raideur ou d’une technique de course inadaptée.
Pour la soulager, il faut suivre 4 étapes :
- apaiser la douleur
- restaurer la mobilité
- renforcer le psoas et les muscles stabilisateurs
- reprendre la course progressivement.
Et pour prévenir sa réapparition, il est essentiel d’intégrer gainage et renforcement, étirements réguliers, foulée efficace, progressivité dans l’entraînement et une bonne récupération.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Comprendre le rôle du psoas en course à pied
Avant de parler douleur, il faut d’abord comprendre qui est ce fameux psoas et pourquoi il joue un rôle aussi central dans notre façon de courir. C’est un muscle qu’on ne voit pas, qu’on ne sent pas toujours mais sans lui, impossible d’avancer efficacement.
Anatomie simplifiée
Le psoas fait partie du groupe ilio-psoas, un duo composé du grand psoas et de l’iliaque. Le grand psoas prend naissance sur les vertèbres lombaires, tandis que l’iliaque s’attache sur l’intérieur du bassin. Les deux se rejoignent pour venir s’insérer sur le petit trochanter, un point situé sur la partie haute du fémur.
En clair, ce muscle relie directement votre colonne vertébrale à vos jambes. Il forme une sorte de passerelle entre le haut et le bas du corps, entre la posture et le mouvement. C’est cette position stratégique qui explique pourquoi, lorsqu’il se tend ou se fatigue, il peut autant impacter votre foulée que provoquer des tiraillements dans le bas du dos ou l’aine.
Fonction en course
En course à pied, le psoas se contracte à chaque foulée pour fléchir la hanche, c’est-à-dire ramener la cuisse vers l’avant. C’est lui qui initie le geste de la montée de genou, indispensable à une foulée fluide et dynamique.
Mais son rôle ne s’arrête pas là : il participe aussi à la stabilisation du bassin et du bas du dos. Quand vous courez, il agit comme un pilier invisible qui maintient votre posture droite et empêche le bassin de « se balancer » dans tous les sens.
Lors des côtes ou des accélérations, il est particulièrement sollicité : le mouvement de flexion devient plus ample, plus rapide, et le psoas doit fournir un effort important pour suivre le rythme. C’est d’ailleurs souvent à ce moment-là que les premières tensions apparaissent.
Reconnaître une douleur au psoas : les symptômes typiques
La douleur au psoas fait partie de ces gênes qui s’installent souvent en douce. On pense d’abord à une petite tension passagère, un manque d’échauffement, voire une simple courbature jusqu’à ce que chaque foulée rappelle qu’il se passe quelque chose de plus sérieux.
Identifier la douleur au psoas
La douleur typique se situe à l’aine, à l’avant de la hanche ou dans le bas-ventre. Parfois, elle descend légèrement vers le haut de la cuisse. Certains coureurs la décrivent comme une brûlure interne, d’autres comme une gêne profonde, difficile à localiser précisément. Cette sensation peut aussi se manifester par un tiraillement ou une raideur dans la hanche, avec parfois l’impression qu’elle « bloque » au moment de lever la jambe.
Au quotidien, les gestes simples deviennent inconfortables : monter les escaliers, sortir de la voiture ou se relever d’une chaise peuvent réveiller la douleur. En course, elle se fait sentir surtout pendant la phase de montée du genou, c’est-à-dire quand le psoas travaille le plus. Elle peut aussi apparaître après l’effort, une fois le muscle refroidi, voire persister au repos si l’inflammation s’installe.
Le syndrome du ressaut du psoas
Dans certains cas, vous pouvez même percevoir un claquement à l’avant de la hanche. C’est ce qu’on appelle le syndrome du ressaut du psoas : le tendon du muscle glisse sur une structure osseuse avant de « raccrocher » brusquement, créant cette sensation de claquement. Ce n’est pas toujours douloureux, mais c’est souvent le signe d’un psoas trop tendu ou mal équilibré.
J’ai vécu ce claquement il y a quelques années, à une période où je passais mes journées assis devant l’ordinateur avant d’aller courir sans échauffement. Mon psoas était tout simplement raccourci et crispé. En reprenant des étirements doux et du renforcement du bassin, la gêne a disparu en quelques semaines.
Si vous ressentez une douleur persistante à l’aine ou une gêne récurrente à la hanche, ne la laissez pas traîner. Le psoas est un muscle profond, et plus l’inflammation s’installe, plus il devient long à apaiser.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Les principales causes de la douleur au psoas chez le coureur
Lorsqu’un coureur ressent une douleur au psoas, ce n’est presque jamais le fruit du hasard. Ce muscle ne se plaint pas sans raison : il compense, il s’adapte, puis finit par dire stop. Comprendre les causes les plus fréquentes, c’est déjà faire un grand pas vers la prévention et vers un retour à une course fluide et sans gêne.
Surutilisation et erreurs d’entraînement
La cause la plus courante reste une surcharge d’entraînement. Une augmentation trop rapide du volume ou de l’intensité (plus de kilomètres, plus de vitesse, plus de côtes) pousse le psoas à travailler au-delà de sa capacité d’adaptation. Résultat : microtraumatismes, inflammation et douleurs à la hanche.
Les séances de fractionné ou de côtes sont particulièrement exigeantes. Ces efforts explosifs sollicitent fortement la flexion de hanche. Si le psoas n’est pas assez préparé ou si l’échauffement est bâclé, il encaisse tout seul la charge.
Personnellement, j’ai appris à ne jamais commencer une séance de côte sans dix bonnes minutes de mobilité et de montée de genoux : ça change tout.
Déséquilibres et faiblesse musculaire
Un psoas douloureux est souvent le symptôme d’un déséquilibre musculaire. Si les fessiers, les ischio-jambiers ou les abdominaux profonds manquent de tonus, le psoas prend le relais pour stabiliser le bassin. À force de compenser, il se contracte en permanence et finit par se tendre.
Un bassin instable ou un manque de gainage amplifient encore ce phénomène. Le psoas, au lieu d’être un moteur, devient un pilier de secours : il tente de maintenir l’équilibre du tronc pendant la course. À long terme, cette sur-sollicitation mène à la douleur.
Raideur ou mauvaise posture
Notre mode de vie joue aussi contre nous. Passer des heures assis devant un ordinateur ou au volant raccourcit le psoas. Ce muscle reste en position raccourcie toute la journée, puis on lui demande soudain de se déployer pleinement pendant un footing : forcément, il proteste.
Le manque d’échauffement avant la course et l’absence d’étirements réguliers aggravent encore cette raideur. Un psoas rigide perd en souplesse et tire sur le bas du dos ou le bassin à chaque foulée.
Technique de course inadaptée
Enfin, la foulée joue un rôle majeur. Une attaque talon, une cadence trop faible ou une posture penchée vers l’avant modifient les angles de travail du psoas et augmentent les contraintes sur lui.
Un manque de mobilité de hanche peut également limiter l’amplitude du geste : le psoas doit alors forcer davantage pour ramener la jambe. À l’inverse, une foulée plus légère, une cadence régulière et une posture droite permettent de réduire la charge sur ce muscle.
Diagnostic : comment savoir si c’est bien le psoas ?
Reconnaître une douleur au psoas n’est pas toujours évident. Ce muscle profond se situe au carrefour de plusieurs structures (bassin, hanche, colonne lombaire) et ses symptômes peuvent facilement prêter à confusion. Pourtant, quelques tests simples permettent déjà d’avoir une bonne idée de son implication avant de consulter.
Tests simples d’auto-évaluation
Un premier test consiste à lever le genou vers la poitrine en position debout ou allongée. Si vous ressentez une douleur ou une tension à l’avant de la hanche, surtout du côté douloureux, le psoas est probablement concerné. Vous pouvez aussi comparer avec l’autre jambe : une différence nette de mobilité ou de confort est souvent révélatrice.
Un autre test, appelé test du psoas allongé, se fait sur le dos : allongez-vous sur une table ou un lit, ramenez un genou contre la poitrine et laissez l’autre jambe pendre dans le vide. Si la jambe pendante reste suspendue sans descendre naturellement, c’est que le psoas de ce côté est trop tendu. Cette raideur peut être un signe de surcharge ou d’inflammation.
Ces tests ne remplacent évidemment pas un diagnostic médical, mais ils peuvent vous orienter et vous aider à mieux comprendre la source de votre douleur.
Diagnostic différentiel
Beaucoup de douleurs situées à l’aine ou à la hanche ne viennent pas forcément du psoas. Il est donc essentiel de ne pas tirer de conclusion trop vite.
- Une pubalgie, par exemple, provoque aussi une douleur à l’aine, mais elle résulte souvent d’une atteinte des adducteurs ou de la symphyse pubienne.
- Une tendinite de la hanche peut irradier vers l’avant, tandis qu’une cruralgie (irritation du nerf crural) provoque des douleurs plus nerveuses, parfois jusqu’à la cuisse.
- Chez certains coureurs plus âgés, une arthrose de hanche ou un conflit fémoro-acétabulaire peuvent également mimer les mêmes symptômes.
C’est pourquoi il est toujours préférable de confirmer le diagnostic avec un professionnel, surtout si la douleur persiste.
Quand consulter un professionnel
Je conseille de consulter un kinésithérapeute, un ostéopathe ou un médecin du sport si :
- la douleur dure plus de dix jours malgré le repos,
- elle s’aggrave à chaque course,
- ou elle perturbe vos gestes du quotidien.
Un professionnel pourra réaliser des tests plus précis, évaluer votre posture, votre mobilité de hanche et votre technique de course. Dans certains cas, une échographie ou une IRM peut être prescrite pour confirmer le diagnostic et écarter d’autres causes.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Soulager la douleur : les 4 étapes du traitement
Bonne nouvelle : une douleur au psoas se soigne très bien à condition d’agir avec méthode et patience. Ce n’est pas le genre de blessure qui disparaît en deux jours, mais avec une prise en charge progressive, on peut retrouver de bonnes sensations sans risquer la rechute. Je vous propose ici une approche en quatre phases, simple et efficace, que j’ai appliquée personnellement.
Phase 1 : apaiser la douleur
La première étape consiste à calmer l’inflammation. Si la douleur dépasse 5/10 ou devient gênante au quotidien, mieux vaut lever le pied. Cela ne veut pas forcément dire arrêt total, mais plutôt adaptation : raccourcir les sorties, éviter les côtes ou les accélérations, et privilégier les terrains souples.
La glace (10 à 15 minutes, deux à trois fois par jour) aide à réduire la douleur. Les automassages doux (avec une balle de massage ou vos doigts) peuvent également détendre la zone, à condition de ne pas forcer. Ajoutez à cela quelques étirements légers, sans chercher l’amplitude maximale.
Pendant cette phase, gardez une activité cardio sans impact : vélo, natation ou elliptique permettent de maintenir votre endurance sans irriter le psoas. C’est une façon intelligente de rester actif tout en laissant le muscle récupérer.
Phase 2 : restaurer la mobilité
Une fois la douleur calmée, il faut redonner au psoas et à ses voisins la souplesse et la mobilité qu’ils ont perdues. Travaillez en priorité les étirements du psoas, mais aussi ceux des fessiers et des ischios-jambiers, qui influencent directement la position du bassin.
Des exercices de mobilité de la hanche et du bassin sont également essentiels. Par exemple, le « bascule du bassin » allongé sur le dos ou les cercles de hanche debout favorisent une meilleure coordination.
Personnellement, j’ai remarqué qu’une simple routine de cinq minutes d’étirements après chaque sortie faisait une différence énorme : la hanche devient plus fluide, et les tensions disparaissent plus vite.
Phase 3 : renforcer le psoas et les muscles stabilisateurs
Quand la mobilité revient, il est temps de renforcer pour éviter la récidive. Commencez par du renforcement isométrique, c’est-à-dire sans mouvement, pour redonner du tonus sans agresser le muscle :
- Gainage frontal et latéral,
- Relevé de genou contrôlé en position assise ou debout.
Puis, passez à des exercices dynamiques :
- Montée de genou avec élastique,
- Pont fessier,
- Gainage avec mouvement de jambe.
L’idée est de recréer une synergie entre le psoas, les fessiers, les abdos et les lombaires. C’est cet équilibre qui garantit la stabilité du bassin et une foulée fluide.
Phase 4 : reprise progressive de la course
La reprise ne doit pas se faire trop tôt. Attendez que la douleur soit inférieure à 3/10 et qu’il n’y ait plus aucune gêne au repos ou à la marche. Commencez par un programme alternant marche et course, sur terrain plat, à allure facile.
Augmentez le volume de 10 à 15 % par semaine maximum, et n’ajoutez l’intensité (fractionné, côtes) qu’une fois la stabilité confirmée pendant au moins deux semaines.
Surveillez vos sensations : une gêne légère qui ne s’aggrave pas est acceptable, mais une douleur qui revient doit alerter. Soyez à l’écoute de votre corps, il est votre meilleur indicateur.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Prévenir la douleur au psoas : les bons réflexes du coureur
Une fois la douleur disparue, le vrai défi commence : éviter qu’elle ne revienne. Le psoas est un muscle exigeant, qui réclame un peu d’attention tout au long de la saison. La bonne nouvelle, c’est qu’avec quelques réflexes simples, vous pouvez le garder souple, fort et coopératif, tout en améliorant vos performances.
Intégrer du gainage et du renforcement chaque semaine
Un psoas en bonne santé dépend avant tout d’un tronc solide. Le gainage est votre meilleur allié : planches, gainage latéral, pont fessier ou relevés de genoux contrôlés renforcent la stabilité du bassin et soulagent le psoas.
Inutile d’y passer des heures : deux à trois séances de 15 minutes par semaine suffisent pour entretenir une base solide. C’est le genre de routine qu’on néglige facilement, mais croyez-moi, elle fait toute la différence sur la durée.
Étirements réguliers et mobilité de hanche
Le psoas déteste la raideur. Après vos sorties, prenez 5 minutes pour étirer les hanches, les fessiers et les ischios. Cela aide à détendre la chaîne antérieure et à maintenir un bon équilibre postural.
Ajoutez quelques exercices de mobilité de hanche (cercles, bascules du bassin, fentes dynamiques) avant vos séances pour préparer les muscles à l’effort. Depuis que j’ai intégré cette habitude, mes jambes sont plus légères, et mes douleurs de hanche ont totalement disparu.
Adopter une foulée efficace
Une bonne technique de course protège naturellement le psoas. Visez une cadence entre 170 et 180 pas par minute, une posture droite et une attaque médio-pied plutôt que talon.
Ces ajustements réduisent l’amplitude de flexion de hanche et répartissent mieux les contraintes musculaires. Cela peut demander un peu de travail au début, mais c’est un investissement durable pour vos articulations et vos performances.
Progressivité des charges d’entraînement
Le corps déteste les changements brutaux. Augmentez vos volumes ou intensités de manière progressive : pas plus de 10 % par semaine, et laissez toujours une journée de repos ou de récupération active entre deux séances intenses.
La patience, c’est la clé. J’ai vu trop de coureurs se blesser par excès d’enthousiasme, moi y compris. En course à pied, celui qui progresse lentement avance longtemps.
Récupération, hydratation et alimentation équilibrée
Enfin, n’oubliez pas les bases : bien récupérer, bien boire et bien manger. Une hydratation suffisante et un apport adapté en protéines, magnésium et oméga-3 favorisent la détente musculaire et la régénération des tissus.
Les massages, les étirements doux et même une bonne nuit de sommeil restent les meilleurs remèdes pour un psoas heureux.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.

