➡️ Découvrir le projet Runcorner : la marketplace de seconde main 100% running
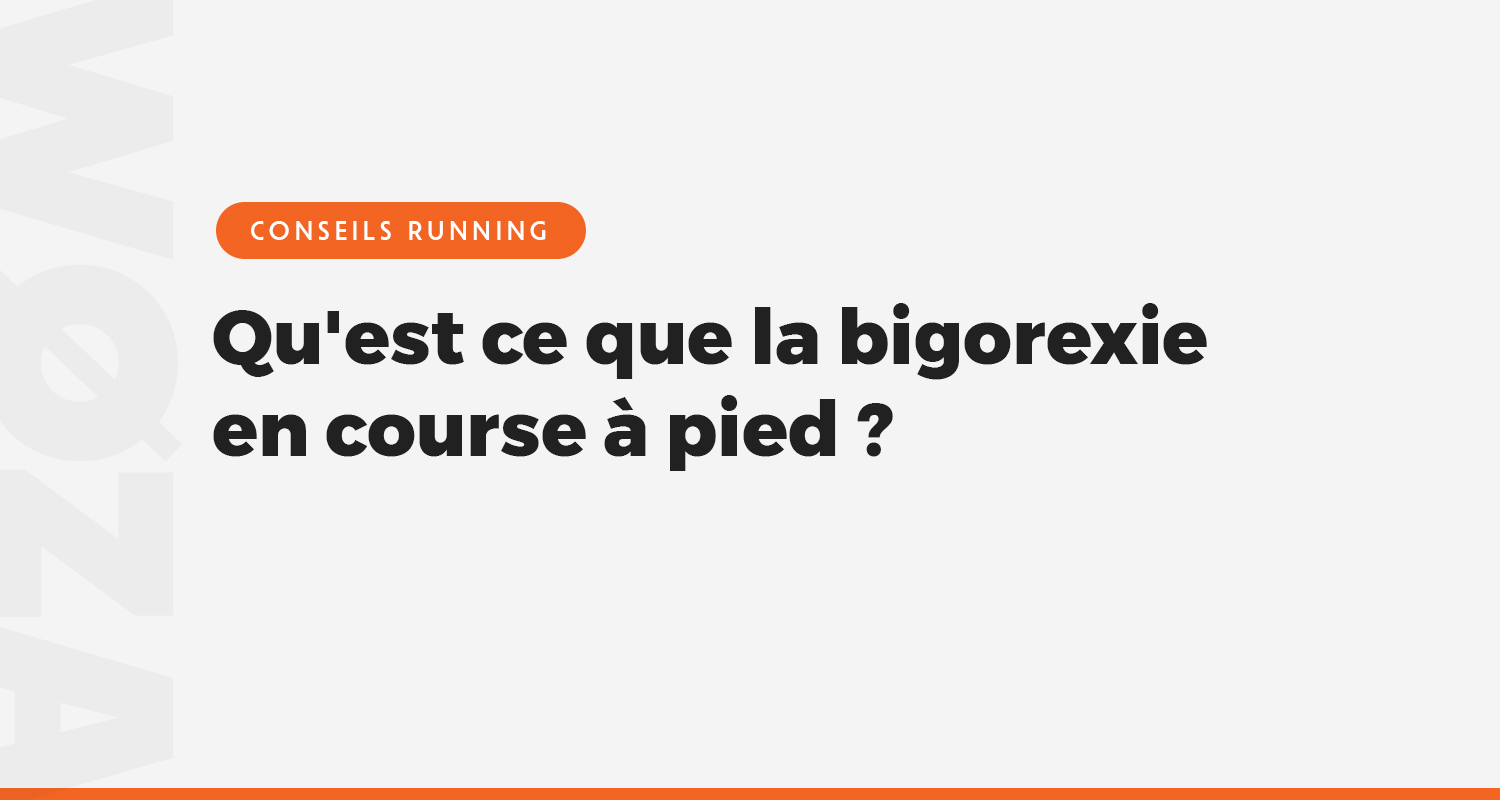
Quand j’ai commencé à courir, je pensais que plus je multipliais les kilomètres, plus je progresserais vite. J’ai connu cette euphorie des débuts où chaque sortie devient une petite victoire. Mais un jour, je me suis surpris à ressentir de la culpabilité après avoir sauté une séance, comme si je trahissais mon plan d’entraînement. C’est là que j’ai compris que la frontière entre passion et excès pouvait être très fine.
La bigorexie, aussi appelée addiction au sport, illustre parfaitement ce glissement. Elle se traduit par un besoin irrépressible de courir, au point que le plaisir s’efface pour laisser place à une contrainte. En course à pied, ce phénomène est loin d’être rare : l’adrénaline d’un fractionné réussi, les endorphines après un long run, ou encore la pression des réseaux sociaux entretiennent ce cercle sans fin.
Dans cet article, je vous propose de mieux comprendre ce qu’est la bigorexie, comment elle se manifeste chez les coureurs, et surtout comment garder une relation saine avec la course à pied. Mon objectif n’est pas de diaboliser l’entraînement, au contraire, mais de vous aider à trouver le bon équilibre pour courir longtemps, et avec plaisir.
La bigorexie : c’est quoi ?
La bigorexie, ou addiction au sport, peut toucher les coureurs et transformer une passion saine en contrainte quotidienne. Elle se manifeste par des signes physiques comme blessures chroniques ou fatigue persistante, des signes psychologiques tels que culpabilité et anxiété en cas d’absence, et des signes sociaux incluant isolement et réorganisation de la vie autour de la course. Plusieurs facteurs favorisent ce trouble : l’effet euphorisant des endorphines, l’obsession des chronos, la pression des réseaux sociaux et les injonctions autour du “corps idéal”.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
La bigorexie : une addiction reconnue
Une définition officielle de l’OMS
Depuis 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît la bigorexie comme une addiction comportementale. Contrairement à une dépendance liée à une substance (alcool, tabac, drogue), elle se caractérise par une compulsion à pratiquer une activité physique. Autrement dit, la personne n’arrive plus à s’en passer, au point que l’absence de sport provoque anxiété, irritabilité, voire un véritable mal-être.
Dans le cas de la course à pied, ce trouble prend souvent la forme d’un besoin incontrôlable d’enchaîner les sorties, sans tenir compte de la fatigue ou des signaux du corps. Ce n’est plus le coureur qui choisit de courir, mais la course qui dicte son rythme de vie.
L’étymologie du mot
Le terme “bigorexie” vient de la combinaison de deux mots :
- “big”, issu de l’anglais, qui signifie “grand” ou “toujours plus” ;
- “orexis”, du grec ancien, qui signifie “appétit” ou “désir”.
Pris ensemble, cela reflète bien le cœur du problème : un appétit insatiable pour l’effort, une recherche constante de dépassement qui ne connaît plus de limite.
Passion, discipline ou addiction : comment les différencier ?
À ce stade, vous pourriez vous demander : “Mais comment savoir si je suis passionné, simplement discipliné ou déjà dans l’excès ?”. C’est une question que beaucoup de coureurs se posent, et la réponse tient souvent dans la manière dont on vit son entraînement.
- La passion : courir procure avant tout du plaisir. Vous avez envie de progresser, mais si une séance saute, vous restez serein.
- La discipline : vous suivez un plan, vous respectez une certaine rigueur, mais cette rigueur reste choisie. Vous pouvez faire des ajustements si nécessaire.
- L’addiction : c’est la bascule. Vous ressentez de la culpabilité si vous ne courez pas, vous forcez malgré la fatigue ou la douleur, et le sport occupe toutes vos pensées.
D’après mon expérience, la clé se situe dans la capacité à accepter le repos. Quand j’ai préparé mon premier marathon, j’étais tellement obsédé par mon plan d’entraînement que je culpabilisais à chaque jour de pause. Avec le temps, j’ai appris que ces moments de récupération étaient aussi essentiels que les séances elles-mêmes. Cette prise de conscience m’a permis de retrouver un équilibre durable.
Les signes et symptômes chez le coureur
Reconnaître la bigorexie n’est pas toujours évident, surtout lorsqu’on associe souvent la régularité et la rigueur sportive à des qualités positives. Pourtant, certains signaux devraient alerter. Chez les coureurs, ces symptômes apparaissent autant sur le plan physique que psychologique et social.
Signes physiques
L’un des premiers indicateurs se trouve dans le corps. Les blessures chroniques deviennent récurrentes : tendinites, déchirures, douleurs articulaires ou encore fractures de fatigue. Le problème, c’est que le coureur bigorexique a tendance à ignorer ces signaux d’alerte. Fatigue persistante, manque d’énergie ou douleurs diffuses sont considérés comme de simples “obstacles” à franchir plutôt que comme des avertissements à écouter.
J’ai moi-même traversé une période où je refusais de lever le pied malgré une douleur au tibia. Résultat : une fracture de fatigue qui m’a immobilisé pendant plusieurs semaines. Cette expérience m’a appris que ne pas écouter son corps finit toujours par coûter plus cher que de s’accorder quelques jours de repos.
Signes psychologiques
La bigorexie ne se limite pas au physique : elle s’installe aussi dans la tête. Beaucoup de coureurs ressentent une forte culpabilité dès qu’ils ratent une sortie. Cette culpabilité peut rapidement se transformer en besoin irrépressible de “rattraper” la séance manquée, parfois en doublant l’entraînement le lendemain.
L’arrêt de la pratique, même temporaire, engendre souvent de l’anxiété, de l’agitation ou de l’irritabilité. Ce ne sont plus seulement les jambes qui réclament l’effort, mais l’esprit qui exige sa dose de sport, comme un manque.
Signes comportementaux et sociaux
Au-delà du corps et de l’esprit, c’est l’ensemble du mode de vie qui peut se retrouver bouleversé. La personne bigorexique réorganise son emploi du temps autour de ses entraînements, parfois au détriment de sa vie personnelle ou professionnelle.
Cela peut créer des tensions avec l’entourage : refus de sortir avec des amis parce qu’il faut se lever tôt pour courir, annulation d’activités familiales pour respecter son plan, ou encore obsession des performances sur les réseaux sociaux et applications de suivi. Peu à peu, d’autres sources de plaisir sont sacrifiées, et la course prend toute la place.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Pourquoi la course à pied favorise la bigorexie ?
Toutes les disciplines sportives peuvent mener à la bigorexie, mais la course à pied a des caractéristiques particulières qui la rendent propice à ce type d’addiction. C’est un sport accessible, facile à pratiquer au quotidien et qui procure rapidement des sensations fortes. Voyons ensemble pourquoi ce terrain est si favorable.
L’effet euphorisant des endorphines
Après une sortie, surtout longue ou intense, le corps libère un cocktail d’endorphines et d’autres neurotransmetteurs liés au plaisir. Cette sensation de bien-être, que l’on appelle souvent le “runner’s high”, agit presque comme une drogue naturelle.
Beaucoup de coureurs cherchent à retrouver ce “shoot” à chaque séance. Avec le temps, ce plaisir devient une nécessité : il ne s’agit plus seulement de courir, mais de ressentir cette dose de satisfaction physiologique.
La quête de performance et l’obsession des chronos
La course à pied attire naturellement les esprits compétitifs. On commence par courir pour le plaisir, puis on veut améliorer son temps sur 5 km, battre son record personnel sur 10 km, ou enfin réussir un marathon.
Cette progression peut être saine, mais elle devient problématique lorsqu’on ne supporte plus l’idée de “ralentir” ou de s’accorder une pause. L’obsession des chronos transforme chaque sortie en test de performance, et l’on finit par courir plus pour battre la montre que pour se faire plaisir.
L’influence des réseaux sociaux et des applications
Des plateformes comme Strava ou Garmin Connect apportent une dimension sociale à la course. Partager ses séances peut être motivant, mais cela nourrit aussi une comparaison permanente. Certains coureurs ressentent une pression implicite à afficher toujours plus de kilomètres ou des allures plus rapides.
J’ai déjà ressenti cette tentation de publier une sortie “impressionnante” après avoir vu le fil d’actualité de mes amis coureurs. C’est grisant, mais cela peut vite transformer la course en vitrine, au détriment de son bien-être.
Les injonctions sociales autour du “corps idéal”
Enfin, il y a les messages omniprésents : “No pain, no gain”, “summer body”, “repousse tes limites”… Ces injonctions valorisent la souffrance et la performance au détriment de l’écoute de soi. Dans ce contexte, beaucoup de coureurs associent repos à faiblesse et effort extrême à mérite. Le risque, c’est de basculer dans un rapport déséquilibré au sport, où l’on ne court plus pour soi mais pour correspondre à une image imposée.
Les risques et conséquences
La bigorexie n’est pas une simple exagération dans la pratique sportive. Ses effets, lorsqu’elle s’installe durablement, peuvent être lourds sur la santé et la vie quotidienne. En course à pied, les conséquences touchent aussi bien le corps que l’esprit et les relations sociales.
Des risques physiques importants
Le premier danger, c’est le corps qui finit par dire stop. Les blessures chroniques se multiplient : tendinites, déchirures musculaires, fractures de fatigue. Le surmenage entraîne une fatigue persistante, un affaiblissement du système immunitaire et, dans les cas extrêmes, des problèmes cardiovasculaires. Courir avec une douleur ignorée ou sous-estimée revient à avancer sur un fil : on pense progresser, mais on fragilise son organisme.
Un impact psychologique marqué
Au niveau mental, la bigorexie installe un climat de tension permanent. L’anxiété s’installe lorsqu’une séance est manquée, la culpabilité devient une compagne quotidienne, et peu à peu la course n’apporte plus de plaisir mais une pression supplémentaire. Dans certains cas, ce cercle vicieux peut mener à des troubles plus graves : épisodes dépressifs, perte de confiance en soi, voire une forme de dépendance qui isole du reste de la vie.
Je me souviens d’une période où je ne courais plus par envie, mais par obligation. Chaque sortie était une lutte intérieure et je finissais frustré si mes performances ne suivaient pas. Cette spirale m’a fait réaliser que courir sans joie n’a plus de sens, peu importe le chrono.
Des conséquences sociales et professionnelles
Enfin, la bigorexie a un coût relationnel. À force de placer la course au centre de tout, on en vient à négliger son entourage, ses loisirs ou même sa vie professionnelle. Annuler une sortie entre amis pour respecter son plan d’entraînement, manquer un repas de famille pour une séance longue, ou arriver épuisé au travail après une série de fractionnés… Ces situations finissent par creuser un fossé avec les proches et rompre l’équilibre global.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.
Comment distinguer une pratique saine d’une addiction ?
La frontière entre passion et dépendance est parfois très fine, surtout en course à pied où la régularité est valorisée. Pourtant, quelques repères simples permettent de savoir si votre pratique reste équilibrée ou si elle bascule vers la bigorexie.
Plaisir ou contrainte ?
Le premier critère à observer, c’est votre rapport au plaisir. Dans une pratique saine, courir reste une source de satisfaction, même si certaines séances sont plus difficiles que d’autres. En revanche, quand la course devient une contrainte, chaque sortie ressemble à une obligation. Vous ne courez plus parce que vous en avez envie, mais parce que vous en ressentez le besoin, sous peine de culpabiliser.
La capacité à accepter le repos
Un autre indicateur précieux, c’est la manière dont vous vivez vos jours de repos. Un coureur équilibré comprend que la récupération fait partie intégrante de l’entraînement. Au contraire, celui qui tombe dans l’addiction vit le repos comme une perte de temps, voire comme une faiblesse.
La place du sport dans vos priorités
Enfin, interrogez-vous sur la place que prend la course à pied dans votre vie. Si elle occupe une position centrale mais cohabite harmonieusement avec votre travail, vos proches et vos loisirs, c’est un signe de bonne santé.
En revanche, si tout s’organise autour de vos entraînements, au point de négliger vos relations sociales ou votre équilibre global, c’est peut-être le signe que la passion a pris une tournure excessive.
Que faire si l’on se reconnaît dans ces signes ?
Prendre conscience que l’on a peut-être franchi la ligne entre passion et dépendance n’est pas simple. Pourtant, c’est déjà un premier pas essentiel vers un retour à une pratique plus équilibrée.
Reconnaître le problème
Tout commence par l’honnêteté envers soi-même. Si vous ressentez de la culpabilité à chaque jour de repos, si vos blessures s’accumulent ou si votre entourage vous fait remarquer que vous ne vivez plus que pour courir, il est peut-être temps de lever le pied. Reconnaître la situation n’est pas un signe de faiblesse, c’est au contraire une preuve de lucidité et de maturité sportive.
En parler à son entourage ou à un professionnel
Le silence entretient l’addiction. En partager les signes avec des proches permet de prendre du recul et d’obtenir un regard extérieur bienveillant. Si la souffrance devient trop forte, se tourner vers un professionnel de santé (médecin, psychologue, addictologue) est une étape clé. Ces interlocuteurs sont là pour écouter et aider, sans jugement.
Se faire accompagner
Un suivi adapté peut réellement faire la différence. Un psychologue peut aider à identifier les causes profondes du besoin compulsif, un addictologue à poser un cadre de soins, et un coach sportif peut vous guider pour réintroduire la récupération dans votre plan d’entraînement. Parfois, un simple rééquilibrage suffit pour retrouver le plaisir.
Réapprendre à intégrer le repos
Le repos n’est pas une perte, c’est une construction invisible. C’est pendant la récupération que le corps assimile l’entraînement, se régénère et progresse. Accepter cette idée change tout. Personnellement, j’ai appris à apprécier mes jours sans course en les voyant comme des alliés plutôt que comme des ennemis. Aujourd’hui, je considère un jour de repos comme une séance à part entière, indispensable pour courir mieux et plus longtemps.
Découvrez 3 modèles de paires de chaussures de running adaptés à votre style de course et à vos besoins grâce à notre comparateur.

